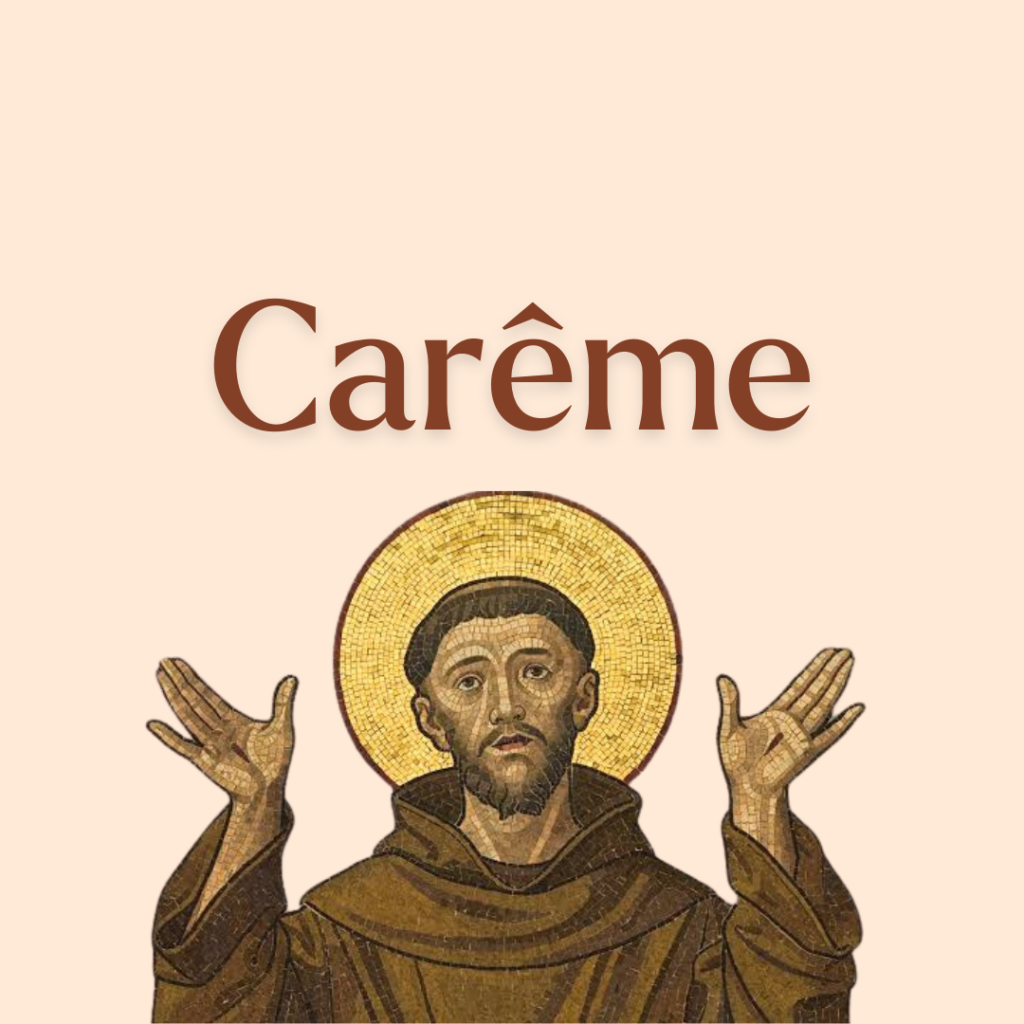D’après le dictionnaire Larousse, « Le Carême est un temps de pénitence pour les catholiques et les orthodoxes allant du mercredi des Cendres au jour de Pâques ». Son origine vient du latin quadragesima dies, signifiant « quarante jours avant ». Des recherches indiquent que le terme quaresme remonte à 1119.
L’idée du Carême est donc relativement récente au siècle de saint François d’Assise. Ce dernier n’emploie le mot que trois fois dans ses écrits, en référence au temps que Jésus passa dans le désert. Cependant, il préconise une période de Carême s’étendant de l’Épiphanie jusqu’à Pâques (1ère Règle 3, 11), une exhortation reprise dans la 2ème Règle (3, 6-7). De plus, il encourage le jeûne et le « retour à Dieu », expression qu’il préfère à « pénitence », de la Toussaint à Noël.
Le Carême est également mentionné au moins douze fois dans ses biographies, notamment chez Thomas de Celano et saint Bonaventure. Une anecdote bien connue illustre sa rigueur : pendant un Carême, il fabriquait un panier tout en récitant Tierce. Pris d’une distraction en observant son ouvrage, il le jeta aussitôt au feu, regrettant d’avoir interrompu son élévation spirituelle (2 Celano 97 et Legenda Major 6).
Saint François menait un Carême extrêmement rigoureux. On raconte qu’il possédait un simple bol de terre cuite pour boire. Lorsqu’il s’abstint de l’utiliser, il le retrouva occupé par des abeilles y fabriquant du miel (2 Celano 169). Il cherchait avant tout la solitude, qu’il considérait comme « l’une de ses dévotions particulières », durant le Carême consacré au Seigneur (Legenda Major, 9, 3). On le retrouve ainsi en retraite à Greccio (Légende de Pérouse 31), au Mont Alverne en l’honneur de saint Michel (Légende de Pérouse 93), à Isola Maggiore sur le lac Trasimène, où il vécut en ermite en ne consommant qu’un demi-pain (Fioretti 7), ou encore à Monte Casale parmi des brigands qu’il finit par appeler « frères » (Fioretti 26).
Outre le Carême précédant Pâques, saint François en menait d’autres. Il était lié de manière indissoluble à la Vierge Marie, jeûnant avec ferveur de la fête des apôtres Pierre et Paul jusqu’à l’Assomption. Par amour pour les anges, il observait un Carême de quarante jours de jeûne et de prière de l’Assomption à la fête de saint Michel. Le souvenir des saints, notamment saint Michel, « intensifiait encore l’incendie d’amour » qui consumait son âme pour Dieu (Legenda Major 9, 3).
Ainsi, les multiples Carêmes de saint François occupaient-ils une grande partie de l’année, expliquant son intense « retour à Dieu », qui le conduisit à recevoir les stigmates sur le Mont Alverne, une consécration de sa contemplation fervente de l’Incarnation et de la Passion (1 Celano 84).
Mais que nous disent aujourd’hui ces Carêmes, à l’ère de l’intelligence artificielle et des sollicitations incessantes des réseaux sociaux ?
Une seule chose essentielle : retrouver la simplicité et l’enfance des béatitudes.
Toutes les distractions du monde ne sont que vertiges et illusions. Notre véritable mission est de faire la paix et donner le bien. Pour y parvenir, nous devons entrer dans un Carême intérieur, aimant et joyeux, un Carême permanent, celui de notre propre consécration religieuse.
Article rédigé par sœur Brigitte Desserre